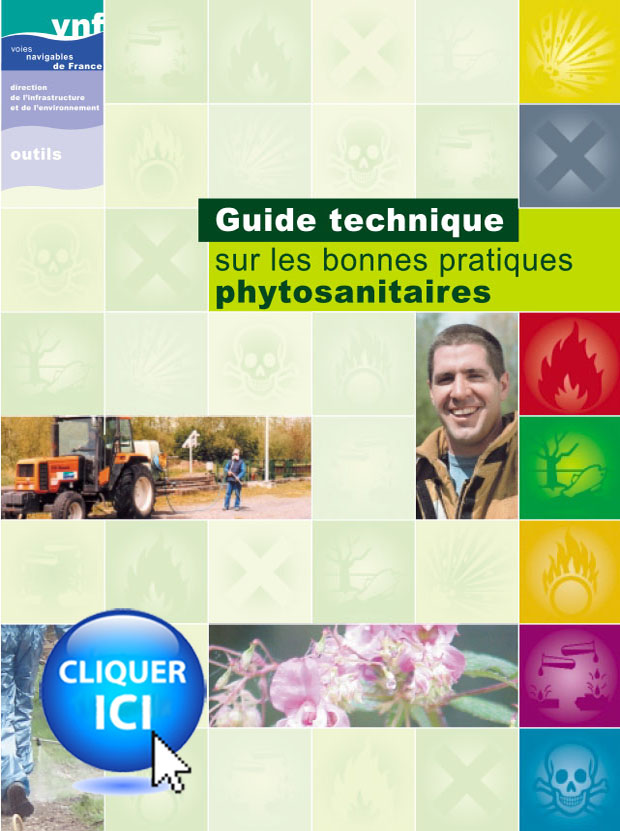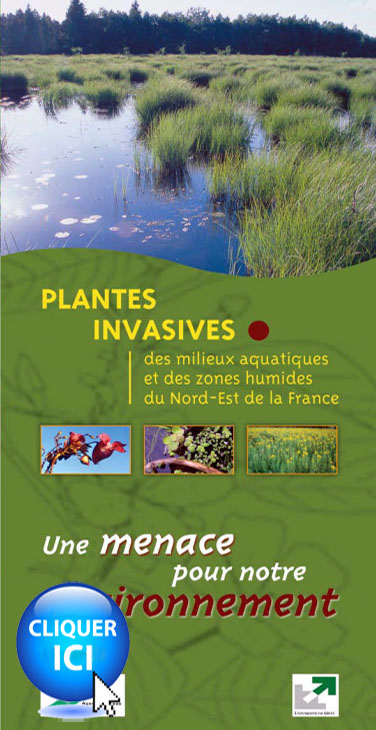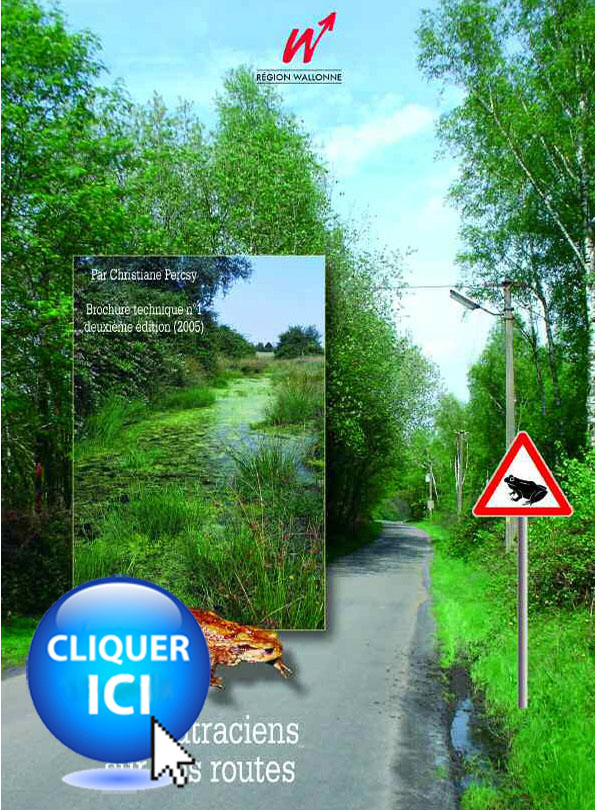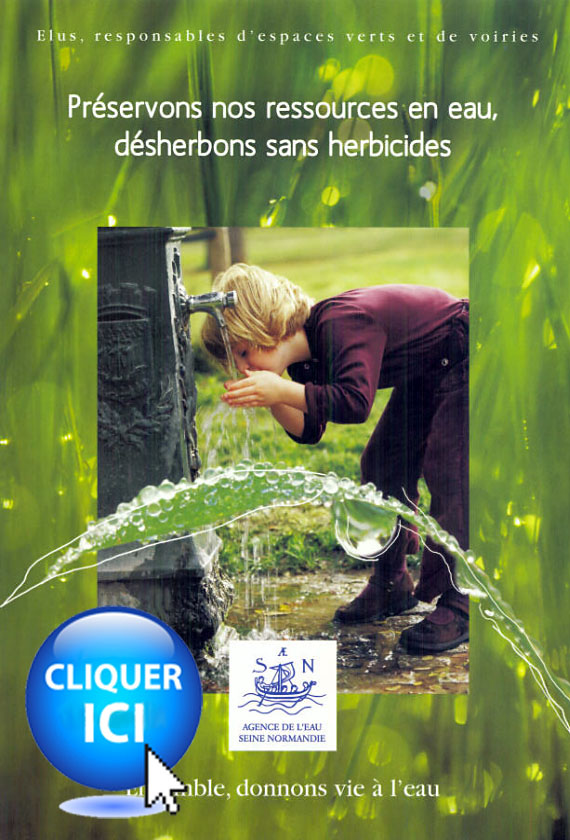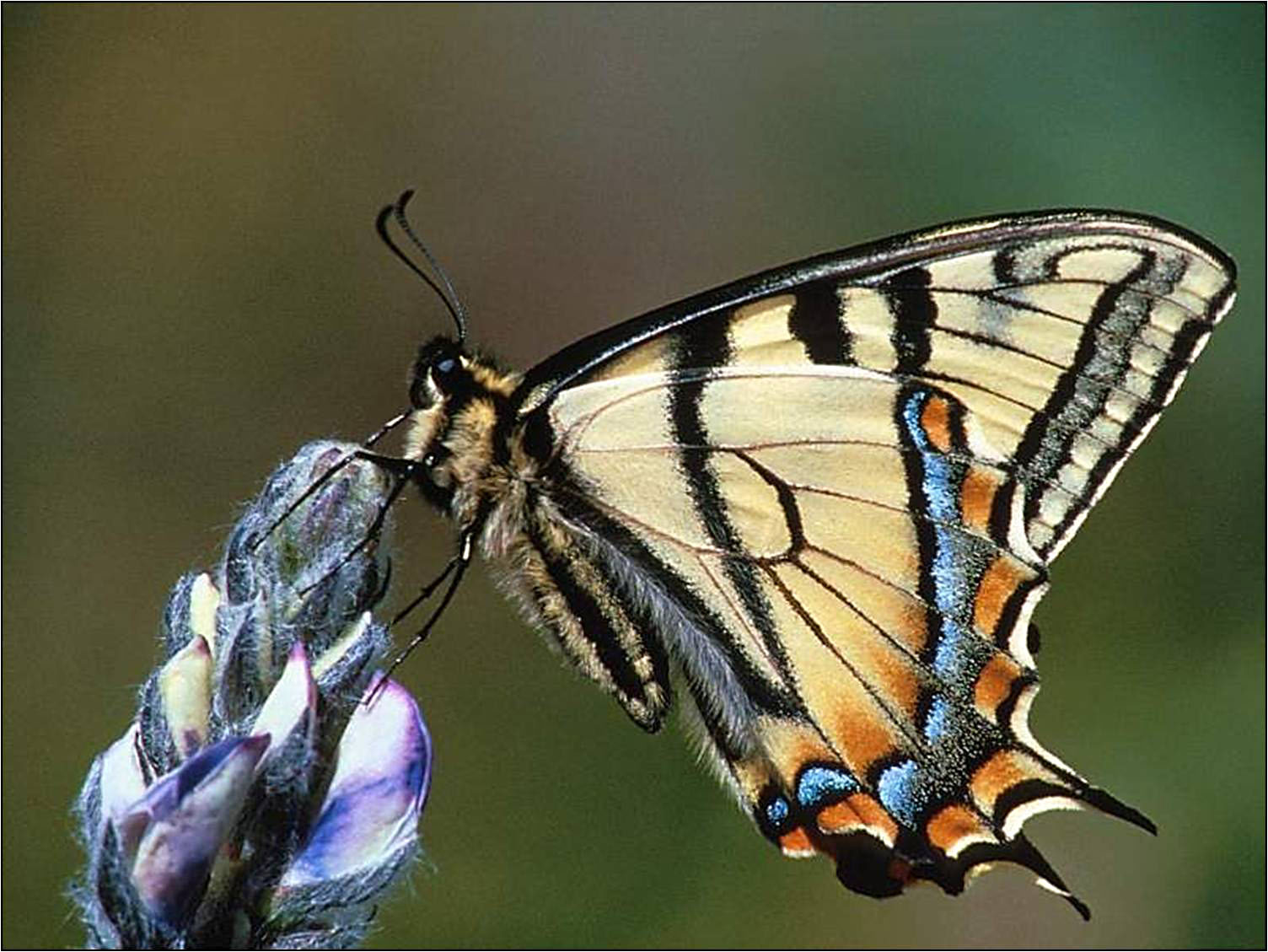Faune & flore à protéger
Bonne pratiques phytosanitaires
Si, après réflexion, vous décidez d’utiliser des produits phytosanitaires, reportez-vous aux conseils de bonnes pratiques, en n’oubliant pas de réaliser un plan de désherbage, et de protéger votre santé et l’environnement. Ce guide liste également des adresses utiles.
Les plantes invasives
Les moyens de lutte les plus efficaces demeurent la prévention et la sensibilisation afin de lutter très tôt en amont, lorsque ces espèces sont présentes mais qu’elles ne prolifèrent pas encore. L’action d’élimination peut alors être efficace pour des petits foyers d’invasion. La surveillance et la gestion des peuplements sont nécessaires, même si elles peuvent entraîner des coûts importants. L’utilisation de produits chimiques comme les herbicides doit être absolument évitée.
Les batraciens sur nos routes
Moyennant la participation de chacun, il est possible d’atténuer l’impact des diverses menaces qui pèsent sur les batraciens, et notamment la mortalité importante due aux traversées des routes. La présente brochure suggère quelques moyens à la portée tant des citoyens que des administrations, à sélectionner selon les situations, en vue de sécuriser les lieux de passage importants.
Traverses de chemin de fer : danger dans les jardins !
Les associations sont sur le pied de guerre. Comme Robin des bois qui a tiré la première la sonnette d'alarme. En Bretagne, côté Finistère-sud, Rivière et bocage « rencontre les municipalités pour les alerter de cette dangerosité d'emploi dans les lieux publics. Mais surtout, insiste la présidente Marie-Claude Colliou, nous tentons de mettre en garde les particuliers. » La « chasse » à la créosote qui se dissout dans la nappe phréatique, s'accumule dans les plantes et les animaux, est ouverte.
Désherbons sans pesticides
Et pourtant diminuer la consommation d'herbicides c'est possible ! En utilisant d'autres méthodes de désherbage (paillage, plantes couvre-sol, désherbage manuel, mécanique ou thermique) ou plus simplement encore, en acceptant la végétation spontanée.
Faune & flore
| Liens |
|
 |
 |
 |